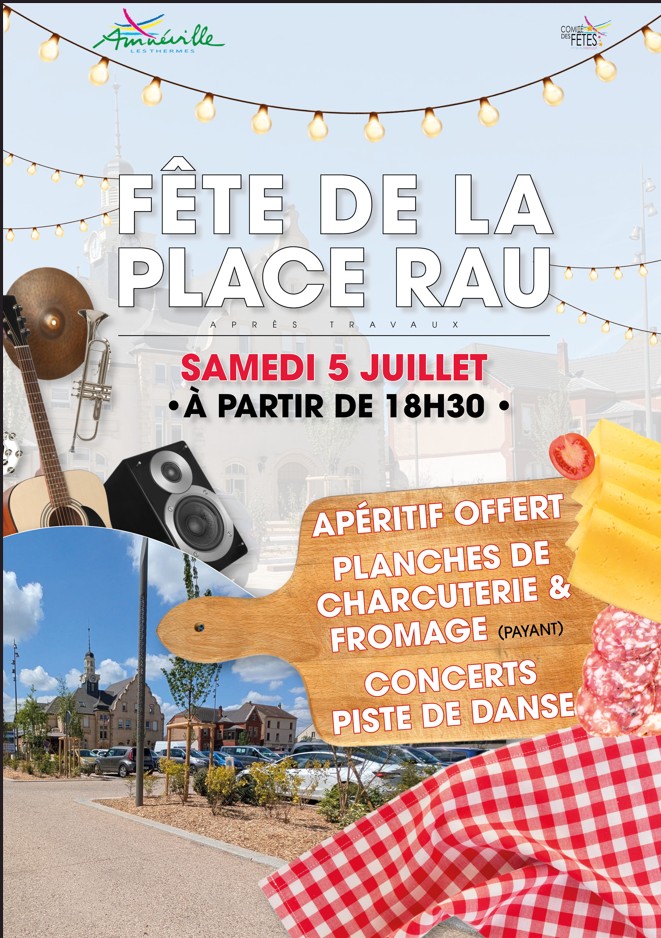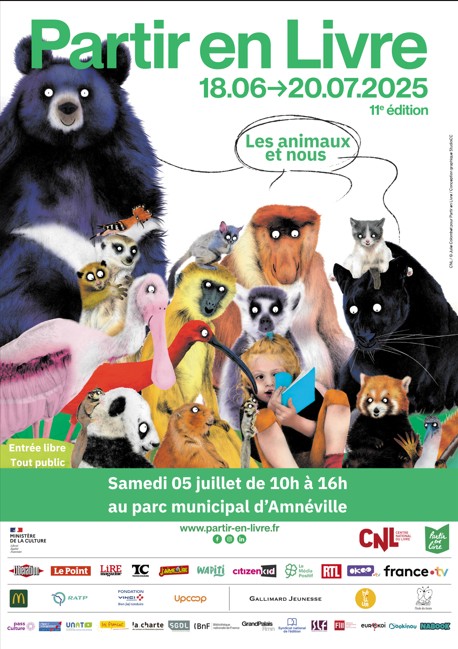☔Vous allez adorer la pluie ☔
Subvention exceptionnelle pour l’achat de récupérateurs d’eau Pour tout achat d’un récupérateur d’eau entre le 1er juillet et le 31 août la CCPOM subventionne 60 % du montant, selon les plafonds suivants : Le dossier doit être déposé au plus tard le 14 septembre 2025. Dossier de demande de subvention
Ouverture du Phoenix
Le Phoenix a ouvert ses portes le 5 mai sur les Portes de l’Orne ! Après plusieurs années de réhabilitation du bâtiment « Énergie », la CCPOM est fière de vous présenter Le Phoenix, un tout nouvel espace dédié à l’entrepreneuriat à Amnéville ! ✨ Un lieu unique pour entreprendre, apprendre et réussir ! 🛠️ Un projet […]
Participez à la consultation des Assises de l'Industrie
Franck Leroy, Président de la Région Grand Est, vous invite à participer à la consultation en ligne préparatoire aux Assises régionales de l’industrie. La réindustrialisation de notre territoire est l’un des défis majeurs que nous devons relever collectivement pour consolider notre économie et préparer l’avenir. À l’approche des Assises régionales de l’industrie, qui se tiendront […]
La CCPOM vous aide à faire des économies tous les jours sur vos trajets du quotidien
Covoiturer tous les jours, c’est opter pour une solution de déplacement économique, simple et écologique. Avec BlaBlaCar Daily et la CCPOM, il en faut peu pour être heureux : 🤝 Formez votre équipe de covoiturage une fois et gardez-la toute l’année.💰 Faites des économies à chaque trajet, peu importe votre rôle.🌎 Réduisez votre empreinte carbone et contribuez […]
Ateliers de Parentalité Numérique
La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle organise un cycle d’ateliers de parentalité numérique, itinérant sur l’ensemble de son territoire intercommunal, pour aider les parents et les grands-parents à mieux accompagner les enfants dans un monde de plus en plus connecté. Ces ateliers, gratuits, ont pour objectif de permettre à chacun de lever les […]
France Services : deux nouveaux espaces
La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle a souhaité améliorer les conditions d’accueil des usagers France services sur le territoire. C’est pourquoi de nouveaux locaux ouvriront : Les usagers peuvent continuer à contacter directement les conseillères France Services qui les accompagneront dans leurs démarches administratives numériques. Les différents lieux à compter du 05 mai 2025 […]
Du nouveau en déchèterie
Depuis le 1er avril 2024, un nouvel exploitant gère les 4 déchèteries de la CCPOM et quelques nouveautés ont été mises en place : Rappel du règlement : L’accès aux déchèteries est réservé aux habitants de la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle munis d’une carte. Le retrait de la carte de déchèterie (1ère demande) peut se […]